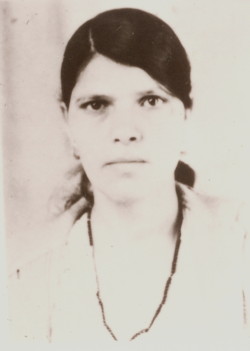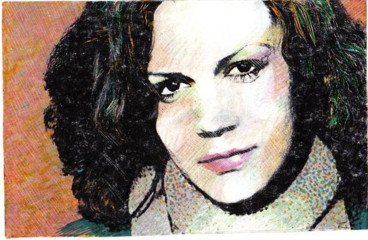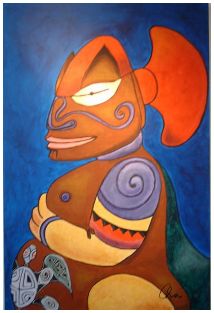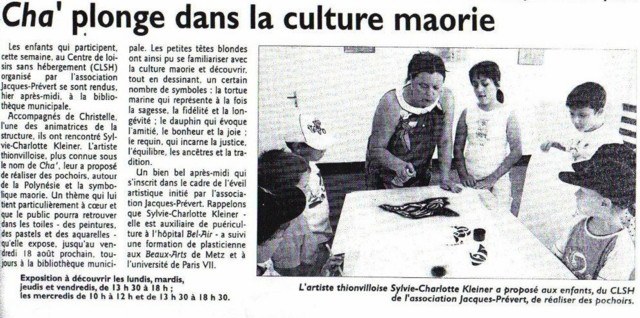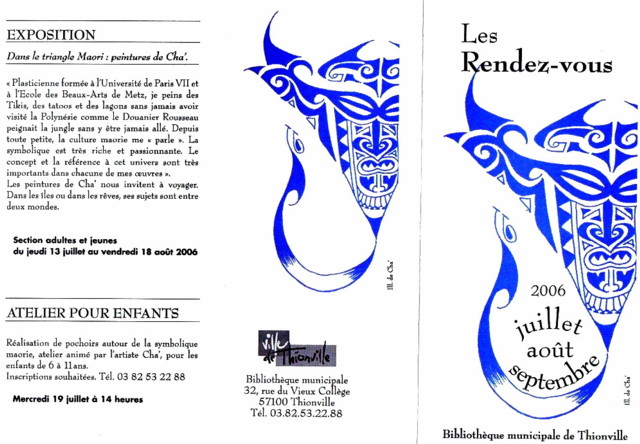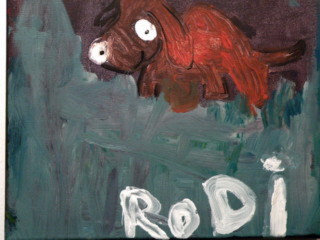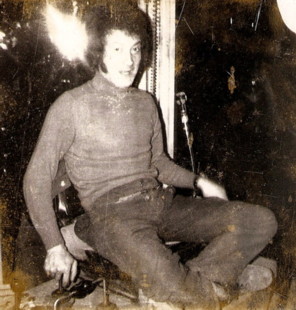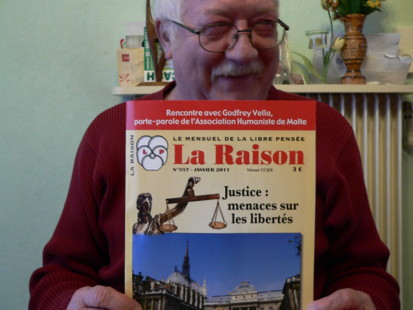Françoise Lambolez habite rue Molière à la côte des roses. Elle a perdu son mari il y a trois ans. Quand elle se réveille le matin, elle se dépêche de se lever quand elle réalise qu’il n’est plus là. Elle ne peut pas rester là à gamberger : elle ne doit pas se laisser abattre.
Françoise est originaire de la région de Remiremont. C’est le déclin de l’industrie textile qui lui a fait quitter les Vosges pour s’installer en lorraine dans les années cinquante. Elle changeait de plus en plus souvent de travail parce que les usines fermaient les unes après les autres. Dans les Vosges, on était payé au mètre pour les rouleaux de tissu ou au poids pour les bobines de fil. On gagnait un peu plus à la Sollac. Son mari était donc parti le premier.


Françoise l’avait rejoint deux ans plus tard à St Nicolas en forêt dès qu’il avait eu un appartement dans les «métalliques», ces immeubles d’acier recouverts de tôle aux reflets d’aluminium dans le soleil. Françoise était contente : un logement neuf avec salle de bain ! Le village de St Nicolas avait été construit de toute pièce au sommet d’une forêt par la Sollac. Il ne figurait d’ailleurs sur aucune carte à tel point qu’en 1958, un pilote d’avion en perdition avait  sauté sur Florange en parachute et laissé son avion filer vers ce qu’il ce qu’il croyait être une forêt. Son avion s’était écrasé sur la place centrale de St Nicolas tuant deux enfants d’âge scolaire. un fokker100 comme celui qui s'est écrasé sur la place St Rita
sauté sur Florange en parachute et laissé son avion filer vers ce qu’il ce qu’il croyait être une forêt. Son avion s’était écrasé sur la place centrale de St Nicolas tuant deux enfants d’âge scolaire. un fokker100 comme celui qui s'est écrasé sur la place St Rita
Les enfants ont grandi et la famille s’est installée à Thionville pour habiter près du collège car Françoise tenait à ce que ses trois fils rentrent manger à la maison entre midi.
Les Lambolez arrivent donc à la côte des roses dans les années soixante dix. Les entrées d’immeubles et les abords étaient plutôt sales mais l’ambiance du quartier était bonne avec tous ces jeunes.
« On a quand même bien rigolé ! » disent ses fils quand ils pensent à leur jeunesse à la côte.

Deux d’entre eux travaillent aujourd’hui chez Peugeot et chez Citroën, le troisième, comme il le voulait tout petit déjà, est devenu gendarme.
Monsieur Lambolez était du même village que sa femme. Elle ne le connaissait pas bien car il avait quelques années de plus qu’elle et si elle avait quatre ans au début de la guerre, lui en avait déjà seize.
Elle se rappelle encore l’arrivée des allemands devant chez sa grand-mère : un soldat l’avait pris sur les genoux et lui avait donné du chocolat. Ils avaient demandé du café à la grand-mère mais celle-ci avait du en boire la première, pour qu’ils voient qu’il n’était pas empoisonné.
Son futur mari n’avait pas pu échapper au STO, service du travail obligatoire en Allemagne. Pour leur forcer la main, les autorités avaient menacé les jeunes d’emmener leur père s’ils se dérobaient. Le STO, c’était dur : douze heures de travail pas jour avec deux litres de soupe comme repas. Monsieur Lanbolez était rentré chez lui à pied avec deux camarades depuis l’Allemagne avec comme toute provision un sac de sucre pour la route. Après la guerre, il s’était engagé et en 1946, il était en Indochine. Voilà pourquoi ils ne se fréquentaient pas. Pourtant ils étaient déjà liés d’une certaine façon car son futur mari, ce qui n’est pas banal, avait été élevé par les parents de sa propre mère comme cela arrivait à cette époque où on plaçait les enfants pour soulager la famille. Après ses trois ans d’armée monsieur Lambolez était revenu au village travailler lui aussi dans le textile et c’est comme ça, qu’à vingt deux ans Françoise l’avait épousé.

A la fin des années soixante, la vie était différente, tout le monde n’avait pas encore de voiture, monsieur Lambolez lui-même avait dépassé cinquante ans quand il avait obtenu le permis de conduire et acheté une R12.
Pour se distraire, les gens restaient dans les environs: il y avait la kermesse, la musique municipale, le marché.
Aujourd’hui il n’y a souvent pas un chat dans la rue, c’est la mort du p’tit cheval !
madame Lambolez et ses deux sœurs ont eu chacune trois garçons!

Heureusement reste sa sœur, veuve également, qui habite impasse de la bécasse depuis vingt ans et qui mange tous les midis avec elle et puis sa voisine madame Scherrer qui vit dans l’immeuble depuis aussi longtemps qu’elle. Avec madame Grasiewicz, une ancienne voisine, elles formaient un bon trio mais madame Grasiewicz a préféré quitter la région quand elle a perdu son mari il y a trois ans. Ce que son mari lui avait refusé toutes ces années, elle l’a fait. Elle a maintenant quatre vingt ans et elle est installée quelque part loin de tous pour réaliser ce rêve : vivre au bord de la mer. Françoise Lambolez l’admire un peu mais n’aurait jamais choisi cette solitude.



réhabilitation
envoyé par saisirlechangement. - Rencontrez plus de personnalités du web.